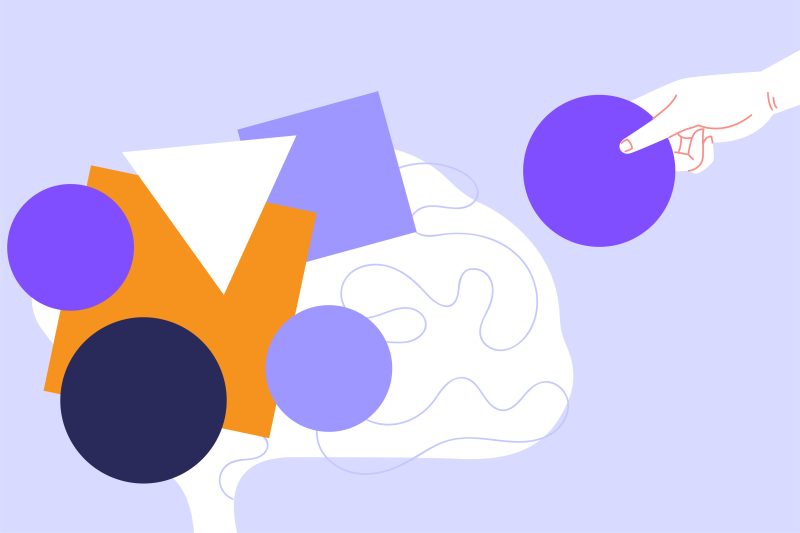A l’occasion de le journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le Centre Gaston Berger (CGB) vous propose de découvrir le trouble du spectre autistique (TSA).
Par Julia Bodénan, psychologue stagiaire au CGB
Comprendre le Trouble du Spectre de l’Autisme[1]
L’autisme est un trouble du neurodéveloppement, apparaissant dès l’enfance et persistant à l’âge adulte. Aujourd’hui, la terminologie « Trouble du spectre de l’autisme » (TSA) permet de mieux prendre en compte la diversité des formes de l’autisme. Les symptômes, tout comme leur intensité, sont multiples et propres à chaque individu. Ainsi, chaque personne autiste peut se situer sur le spectre en fonction de ses singularités.
Les caractéristiques du Trouble du Spectre de l’Autisme
Selon le DSM-5 (manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), les TSA se caractérisent principalement par :
- Des difficultés dans la communication et les interactions sociales, qui peuvent se manifester au travers d’un déficit dans la réciprocité émotionnelle et sociale, de comportements non verbaux altérés ou de difficultés dans le développement ou le maintien des relations sociales et leur compréhension.
- Des comportements, intérêts et activités spécifiques et répétitifs ; cela peut inclure des mouvements et vocalisations répétitives et stéréotypées, une adhésion inflexible aux routines et une intolérance au changement, des intérêts spécifiques ou fixes, tant dans leur intensité que dans leur objectif. En outre, les TSA peuvent également se caractériser par des particularités sensorielles, quel que soit le sens (hypersensibilité aux sons, à la lumière, aux odeurs…).
D’autres troubles sont régulièrement associés à l’autisme, pouvant impliquer des troubles psychiques, développementaux ainsi que d’autres troubles neurologiques. Les troubles de l’apprentissage, de l’attention, de l’anxiété, dépressifs et du sommeil sont les plus fréquents. Ils sont particulièrement importants à considérer car ils risquent d’impacter la capacité d’adaptation de la personne à son quotidien.
La prise en charge des personnes présentant un trouble du spectre autistique
Un accompagnement adapté et préventif repose sur une évaluation globale du profil de la personne autiste, en s’appuyant sur ses points forts et ses difficultés. Plusieurs approches comportementales, développementales et éducatives peuvent être particulièrement bénéfiques. A ce jour, il n’existe pas de traitement médicamenteux spécifique pour l’autisme, néanmoins des traitements pour certains symptômes peuvent être performants.
La prise en charge peut impliquer différents professionnels selon la complexité du trouble. En première ligne, le médecin traitant peut réaliser un premier dépistage et, si nécessaire, orienter vers des spécialistes pour des investigations plus approfondies. Les équipes spécialisées dans les troubles neuro-développementaux, notamment celles exerçant dans les Centres de ressources autisme (CRA) ou en milieu hospitalier, disposent d’outils spécifiques pour affiner le diagnostic et proposer un accompagnement adapté. Dans un certain nombre de situations, un accompagnement pluridisciplinaire peut être utile pour permettre une adaptation aux différentes facettes de la vie personnelle, professionnelle et sociale.
Le diagnostic du TSA
Le diagnostic de l’autisme est clinique. Il repose sur les critères du DSM-5 ainsi que sur une observation approfondie de la personne et de son fonctionnement au quotidien : ses acquis, ses compétences, ses besoins et ses limitations. Des tests de dépistage et des évaluations psychométriques peuvent être réalisés en complément de cette observation clinique.
Le DSM-5 distingue plusieurs niveaux de sévérité du TSA :
- Niveau 1 : nécessitant un soutien léger et un accompagnement adapté.
- Niveau 2 : nécessitant un soutien important.
- Niveau 3 : nécessitant un soutien très important, avec une possible déficience intellectuelle associée.
On peut noter que l’image que véhicule en particulier le cinéma sur le TSA relève le plus souvent du niveau 3, alors que dans la réalité les 3 types de TSA sont présents.
Les personnes autistes peuvent donc être impactées dans le quotidien selon différents degrés de sévérité. Il est donc essentiel de questionner régulièrement les prises en charge pour offrir un accompagnement optimal à chaque individu.
L’augmentation des diagnostics à l’âge adulte : l’autisme au féminin
On observe une augmentation des diagnostics à l’âge adulte, notamment chez les femmes. Ce diagnostic tardif s’explique par plusieurs facteurs, notamment des biais de genre dans la recherche scientifique, qui s’est historiquement concentrée sur l’autisme masculin, rendant les profils féminins moins visibles. Par ailleurs, les femmes autistes développent plus fréquemment que les hommes des stratégies de compensation et de camouflage social, leur permettant de masquer leurs difficultés. Alors que certains traits comportementaux alertent les parents de jeunes garçons (retrait social, réserve, anxiété par exemple) conduisant à une évaluation parentale de potentiels troubles autistiques, ces mêmes comportements chez les jeunes filles peuvent être minimisés en raison de biais de genre ce qui retarde d’autant la pose du diagnostic pour les femmes.
Le syndrome d’Asperger : qu’en est-il aujourd’hui ?
Le terme « syndrome d’Asperger » utilisé dans des classification antérieures pour désigner les personnes autistes sans déficience intellectuelle a été intégrée aux troubles du spectre de l’autisme dans le DSM-5 et n’existe plus en tant que catégorie diagnostique distincte. Cependant, les termes « asperger » ou « aspie » restent utilisés par certaines personnes ayant reçu ce diagnostic avant la modification des classifications, et peuvent revêtir une dimension identitaire pour certains individus autistes.
Le Centre Gaston Berger, engagé sur les questions de santé
La santé des apprenant.e.s et la gestion de son impact sur leurs apprentissages et leur vie étudiante constituent un enjeu majeur pour le Centre Gaston Berger. Mieux connaître les troubles contribue à mieux vivre nos différences et à mieux interagir.
La psychologue conseil de l’école est également là pour accompagner plus spécifiquement les élèves concernés. Elle est joignable par mail bien-etre.etudiant@insa-strasbourg.fr.
Pour aller plus loin et approfondir cet article, le CGB vous propose quelques ressources complémentaires.
A découvrir aussi
Une sélection d’ouvrages est disponible à la bibliothèque de l’INSA Strasbourg :
- La différence invisible de Julie Dachez (Ed. Delcourt, 2016).
- Manuel de l’autiste de Martin Desseilles et al. (Ed. Eyrolles, 2022)
Découvrez également les sites autismeinfoservice.fr/, autisme-france.fr, strasand.fr/ et typik-atypik.fr qui complètent également cet article.
N’hésitez pas à contacter le CGB : cgb@insa-strasbourg.fr
[1] Sources :
Hull, L., Petrides, K. V., Allison, C., Smith, P., Baron-Cohen, S., Lai, M., & Mandy, W. (2017). “Putting on My Best Normal” : Social Camouflaging in Adults with Autism Spectrum Conditions. Journal Of Autism And Developmental Disorders, 47(8), 2519‑2534. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3166-5
Les femmes autistes. (s. d.). Comprendre L’autisme. https://comprendrelautisme.com/lautisme/les-femmes-autistes/
Sulkes, S. B. (2024, 10 mai). Troubles du spectre autistique. Édition professionnelle du manuel MSD.